Jay Pather, Impressions d'un discours
25 ans après l’abolition de l’apartheid, Le Cap reste une ville divisée. Dans ces extraits de son allocution préliminaire, Jay Pather, commissaire du festival Infecting the City, interroge le public sur l’impact possible d’un changement de lieu et d’identité pour l’Afrique du Sud.
L'article fait partie de la publication FRESH STREET#3 coordonnée par Circostrada et éditée par John Ellingsworth, en lien avec le FRESH STREET #3 - Séminaire international pour le développement des arts de la rue co-organisé en octobre 2019 par Circostrada, ARTCENA en partenariat avec Galway 2020 Capitale européenne de la culture et ISACS à Galway, Irlande.
Lieu et identité forment une thématique aussi fascinante que délicate. En tant qu'êtres humains, nous croyons fermement aux belles histoires - qui ont un début, un milieu et une fin. En matière de lieu et d’identité, nous espérons des progrès et des transformations, qui eux-mêmes aboutiront à une entente et une paix mutuelles. Comme dans toute belle histoire, nous avons bon espoir que la situation de nos sociétés s’améliorera. Il est d’autant plus consternant pour l’âme et choquant pour l’esprit humain d’observer tous les signes d’une profonde crise d’inégalité des droits et économique, déclenchée par une économie mondiale insatiable au service d’une infime minorité.
Cette crise s’accompagne d’une attaque sur la migration, un phénomène qui touche les peuples depuis la nuit des temps. Une belle histoire se bâtit autour de la fluidité des frontières, d’échanges entre peuples d’origines diverses… Une pluralité désormais menacée. La montée du nationalisme sévit, non seulement en Europe et aux États-Unis, mais aussi au Brésil, en Israël ou encore en Inde. Si le nationalisme n’est pas foncièrement mauvais lorsqu’il s’agit d’affirmer son héritage, nos crises actuelles ont fait émerger un nationalisme réactionnaire et radical, nourri par des intérêts personnels ainsi que par l’ignorance et la peur. Lorsqu’un consensus peine à se dégager, l’effet sur tous les êtres sensibles est dévastateur. À cela s’ajoute notre entrée dans « l’Anthropocène », une ère où les actions de l’Homme vis-à-vis de la planète et de notre écosystème sont irréversibles. En Afrique australe, où de récentes inondations ont tué 400 personnes, le concept d’identité est devenu un luxe, dans un contexte d’événements plus cruels les uns que les autres.
Ce débat est animé de nombreuses contradictions. De la modernité est née la mondialisation, laquelle a ouvert les flux migratoires. Une migration qui a provoqué la fermeture et le resserrement des frontières, ainsi qu’une montée de ce nationalisme méprisant la diversité - un concept qui devait être au centre de la mondialisation. Je suis convaincu que les artistes sont les mieux préparés pour aborder ces complexités, contradictions et hypocrisies : la performance artistique s’intéresse à la mutation, à l’incarnation et à la critique, mais aussi à une vision multidimensionnelle capable de s’affranchir des frontières, de la couleur de peau, de la classe sociale et de la sexualité. En saisissant cette dynamique du changement, l’art peut présenter l’identité non pas comme une notion monolithique, mais comme un concept malléable, flexible et complexe.

Laissez-moi m’éloigner de l’Europe pour me focaliser sur l’Afrique du Sud, mon pays natal où les concepts du lieu et de l’identité occupent une place centrale dans nos débats nationaux, depuis la venue au pouvoir de Nelson Mandela, en 1994. Dans les pays colonisés comme le mien, la notion de modernité n’a jamais été l’oeuvre des nations indigènes. Elle nous a été imposée par l’Occident - comme l’a été la mondialisation, au départ favorisée par la migration, mais aussi par l’appropriation violente d’une terre, d’une identité, d’un nom, d’une culture et de nos nationalismes.
L’indépendance de l’Afrique du Sud, en 1994, a été un résultat durement acquis. Parallèlement à l’accès au pouvoir de Nelson Mandela, la création de la Commission de la vérité et de la réconciliation (CVR) a été un vrai cadeau pour le reste du monde, ainsi qu’un moyen de réunir oppresseur et opprimé. L’histoire était séduisante de par sa pureté et sa résonance dramatique : paroxysmes, volte-face, grands gestes de compassion et indispensables dénouements. La CVR allait permettre de récupérer un lieu et une identité. En d’autres termes, de mettre un point final à l’apartheid, qui restait néanmoins une question complexe, une problématique immense, interminable, systémique, multimodale et généralisée. Le problème ne résidait pas dans les actions de dictateurs, mais dans les actes menés par des gens ordinaires à l’encontre d’autres gens ordinaires.
Surtout, la CVR a passé sous silence une réalité : le maintien des richesses et des terres du pays entre les mêmes mains que durant l’apartheid. Le sujet des réparations n’a pas été évoqué, et les terres comme les richesses n’ont jamais été redistribuées. Vingt-cinq ans après l’accès au pouvoir de Nelson Mandela, l’égalité riches-pauvres et Blancs-Noirs est encore loin d’être une réalité. Les statistiques actuelles sont éloquentes : le taux de chômage national atteint 30 %, tandis que 65 % des Noirs vivent dans la pauvreté. En matière d’économie mondiale, l’Afrique du Sud fait du surplace. Notre monnaie rivalisait avec le dollar américain au summum de l’apartheid, mais il chuta à un taux de 12 rands pour 1 dollar lors de l’accession au pouvoir de Nelson Mandela. La non redistribution des terres a gardé nos marchés fragiles, mais sûrs. Craignant une redistribution des terres et inquiets pour l’économie du pays, les Blancs sud-africains possèdent, aujourd’hui encore, exactement ce qu’ils possédaient durant l’apartheid.
Au coeur du quartier d’affaires du Cap, le festival Infecting the City essaie de tirer quelque chose de ce triste constat. Le terme « Infection » est chargé de connotations négatives. Comme la ville, le corps est un espace sacré mais contesté, protégé par une peau quoique poreuse et vulnérable. En « infectant » volontairement la ville, nous jouons avec l’étymologie du terme et agissons consciemment pour façonner le lieu et l’identité. Le Cap a remporté le Prix Travellers’ Choice de TripAdvisor, et a été élue « Meilleure destination d’Afrique » par les World Tourism Awards. Le Cap est également le berceau de l’apartheid qui, 25 ans après son abolition officielle, est toujours visible dans la topographie de la ville, où banlieues blanches sont soigneusement séparées des townships noirs.
De nombreuses oeuvres du festival abordent directement ce problème. En 2014, Phumulani Ntuli crée, avec Nkateko Baloyi et Pule Magopa, Umjondolo, une pièce qui exporte métaphoriquement le township en banlieue, par la reconstruction de bidonvilles dans les quartiers périphériques du Cap. En 2013, Tebogo Munyai se rend à Thibault Square (dans le quartier d’affaires de la ville) et y installe des cabanes aux parois criblées de balles. Les occupants (des comédiens) restent invisibles, sauf lorsque le spectateur regarde à travers les impacts de balles, qui ne laissent entrevoir qu’une petite partie de l’existence de ces habitants. L’installation réveille un côté « voyeur » tout en évoquant intelligemment la situation actuelle : regarder, mais ne pas agir.
Le festival poursuit un autre objectif : investir le quartier d’affaires (lieu inconnu par de nombreux Sud-Africains) et en faire un lieu familier, c’est-à-dire le transformer en un espace où on peut manger, découvrir des parfums et des saveurs. L’installation de la parfumeuse Tammy Frazer, par exemple, embaume les fontaines de la ville de parfums des bois. Dans son oeuvre Processional Walkway, Katie Urban, quant à elle, installe des tapis de pétales de rose partant de la gare principale du Cap, où transite la majeure partie de la classe ouvrière qui vit dans les townships reculés et travaille en centre-ville. Ces tapis s’étendent de la gare jusqu’au coeur de la ville.
De nombreuses oeuvres traitent de la mémoire. Le sujet reste tabou, mais Le Cap était un haut lieu du commerce d’esclaves, venant notamment d’Indonésie et de Malaisie, mais aussi de diverses régions d’Afrique. Ces esclaves sont enterrés dans divers lieux. En 2012, Nicole Sarmiento, Memory Biwa et Tazneem Wentzel ont cherché à savoir où se trouvaient ces cimetières d’esclaves. Disséminée dans toute la ville, la série de performances rituelles, The Callings, est le fruit de leurs recherches. Dans une autre exposition, l’artiste Haroon Gunn-Salie a créé Witness au coeur du District Six, un quartier détruit par le gouvernement durant l’apartheid, pour y reconstruire de nouveaux logements. La destruction d’un lieu qui, à l’époque, a également signifié celle d’une communauté tout entière. De nouvelles maisons aux façades blanches ont été construites, mais très peu d’entre elles ont trouvé preneurs. En hommage à ces maisons désertes, Haroon Gunn-Salie a placé divers objets au milieu de pièces vides aux murs blancs : une tasse en fer émaillé, un chat en porcelaine recouvert de givre, un tapis de prière, une robe de bal abandonnée en taffetas - autant de souvenirs d’une communauté expulsée à jamais.

De nombreux artistes ont également travaillé sur la reconstruction de lieux sur une note plus positive. Neo Muyanga a ainsi présenté son opérette dans la Groote Kerk, un ancien bastion de l’apartheid sud-africain situé face au quartier des esclaves, la Slave Lodge. Neo Muyanga a collaboré avec une chorale du township de Khayelitsha et, à partir d’un poème d’Antjie Krog sur le thème de la réconciliation, a créé des performances aussi belles qu’émouvantes à propos de la douleur engendrée, de la trahison et de la guérison. L’émotion était vive dans le public, compte tenu du symbole de cette église, mais aussi de ce que l’oeuvre tentait de communiquer depuis ce lieu.
Cela nous amène au dernier acte du festival, dédié à la résilience et au rêve. Les artistes ont pu s’exprimer sur le lieu et l’identité en tant que concepts réalisables, par le biais de l’adaptation et de la résilience. Artiste contemporaine et universitaire, Khanyisile Mbongwa a ainsi créé iRhanga, une oeuvre rendant hommage aux allées parcourant les townships noirs.
Évoquant le théoricien Jordache A. Ellapen (pour qui le township n’est ni moderne ni rural, mais un espace hybride), Khanyisile Mbongwa conçoit la ruelle comme une « frontière dans la frontière » - un espace qui, selon l’artiste, est pleinement conforme au concept de « monde sans intervalles » décrit par Frantz Fanon. Elle poursuit : « Les espaces des townships sont souvent représentés comme temporaires et inhabitables. Comment, dans ce cas, l’existence de la ruelle fait-elle naître des dialogues beaucoup plus complexes autour des paradoxes de l’expérience vécue par les Noirs ? Si les townships sont le fruit de l’apartheid, où se trouvent les espaces de résilience créés par la population – des espaces qui persistent dans l’Afrique du Sud post-apartheid ? » Selon Khanyisile Mbongwa, c’est précisément au coeur de la ruelle que jaillit l’imagination radicale noire.
Khanyisile Mbongwa écrit également au sujet d’une danse, la « Pantsula », née dans les townships et qui s’est depuis répandue dans tout le pays : « La Pantsula repose sur un jeu de jambes - qu’il soit complexe, accéléré ou ralenti - car c'est avec les pieds que vous courez, travaillez ou vous rendez à la gare. Dans la Pantsula, les danseurs alternent marches rapides, courses, sauts et arrêts soudains. Cette danse incarne la révolution silencieuse de ceux qui ont osé aller au-delà d’un espace abject, conçu pour faire d'eux des êtres passifs et dociles. »

Le programme d’Infecting the City incarne cette vélocité à l’échelle sociale : le rythme du changement, la réalité de l’effondrement, mais aussi la reconstruction et le renouvellement du lieu et de l’identité dans nos sociétés. Le désir de stabilité dans nos espaces et de réconfort dans nos foyers reste cependant un défi.
Une oeuvre d’Aeneas Wilder, Under Construction, avait clôturé une précédente édition du festival. Placée au coeur du District Six (où des dizaines de milliers d’expulsions ont eu lieu pendant l’apartheid), l’oeuvre consistait en une structure en bois minutieusement construite – un travail à la fois complexe et fragile. Les éléments n’étant pas vissés entre eux, la structure était « autoportante », dans un équilibre très précaire. Après plusieurs jours de construction, Aeneas Wilder a détruit – en fanfare – la construction en quelques secondes lors de la dernière journée.
De telles oeuvres rappellent qu’en Afrique du Sud, la notion de « faire de la place » (au moins en ce qui a trait au concret, à la durabilité, à la stabilité et à la solidité) nous échappe aujourd’hui encore. Elles nous rappellent aussi que l’alchimie entre art vivant, public et espaces publics est toujours sujette à un questionnement passionné ainsi qu’à une réinvention… infectieuse. Ces oeuvres nous laissent entrevoir les turbulences d’une société profondément instable, les répliques des catastrophes du passé, ainsi que les futurs possibles. Pour l’instant, ces clins d’oeil sur la réinvention du lieu constituent des actes - bien que surtout performatifs et temporaires - extrêmement puissants et durables. Ces oeuvres nous invitent, dans leur temporalité, à nous confronter au besoin impérieux d’une composante plus intégrale, au sein de nos sociétés mondiales et locales. Un miroir et une flamme qui allument des transformations du pouvoir plus importantes, et qui offre à tous nos concitoyens le luxe d’un espace où ils ne pourront plus être déplacés ni expulsés ; des identités qui favorisent la multiplicité, le choix, la tolérance, l’autodétermination, le respect et la dignité.

Jay Pather est professeur associé à l’Université de Cape Town, directeur de l’Institut pour les Arts Créatifs (ICA), commissaire des festivals Infecting the City et Live Art de l’ICA, ainsi que directeur artistique de la compagnie Siwela Sonke Dance Theatre. Il a récemment délivré des discours dans le cadre du Festival of the Future City (Royaume-Uni), Independent Curators International (New York) et à la Haus der Kunst (Munich). Il a publié des articles dans Changing Metropolis ll, Rogue Urbanism, Performing Cities, Where Strangers Meet and the book, Transgressions, Live Art in South Africa.
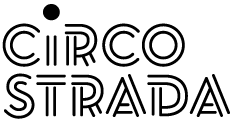


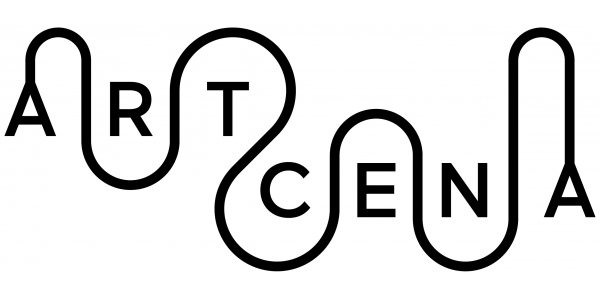


écrivez-nous : infocircostrada@artcena.fr