FRESH STREET #4 - Matière à penser : PRATIQUE ARTISTIQUE, BIENVEILLANCE RADICALE un article de Roselle Pineda
La pandémie a accentué les inégalités et l’insécurité, mais a aussi créé un espace pour repenser nos structures fondamentales. Si d’autres se saisissent de cette opportunité, pourquoi pas les artistes ? La conservatrice et artiste Roselle Pineda parle d’union des communautés et de qualité de vie.
Lorsque l’Organisation Mondiale de la Santé a qualifié le Covid-19 de pandémie, en mars 2020, le monde tel que nous le connaissions s’est arrêté. De nombreux pays ont instauré un confinement, qui nous a forcés à nous isoler en lieu sûr. Même à ce moment-là, nous faisions face à un avenir incertain dans lequel, à condition de survivre, la plupart d’entre nous devrait ensuite affronter une crise économique mondiale. Pour reprendre un proverbe chinois, c’est comme si le vent s’était levé dans la nuit et avait emporté tous nos projets : nous nous sommes subitement retrouvés dans une période étrange et un espace d’attente perpétuelle. La pandémie nous a précipités dans un état de précarité, qui nous a contraints à vivre deux situations extrêmes, opposées dans le temps et l’espace — l’immobilité forcée, à mesure que nous nous confinons toujours un peu plus dans nos propres petits espaces et bulles temporelles; et l’hypervitesse, au travers du nombre d’infections et de décès et du volume d’informations que nous découvrons sur le virus, qui changent à une rapidité jamais vue. Une panique très palpable s’est installée au moment où les fondations de l’ordre mondial actuel, retranché dans l’accumulation de capital, ont commencé à vaciller, s’effondrant pour écraser les plus vulnérables et marginalisés.

En effet, la pandémie a intensifié ce que Judith Butler évoque dans son livre Notes Toward A Performative Theory of Assembly, à savoir le « déclin » des piliers et des systèmes de soutien de/dans notre société. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons faire face à la nouvelle de personnes qui perdent leur emploi ; à la situation de personnes privées de droits et à qui l’on a arraché le choix de rester chez elles, parce que leur survie dépend d’un salaire quotidien ; à la situation des immigrants, qui ont représené une grande part des emplois en première ligne pendant la pandémie, d’autant plus précaires du fait de leur statut de résident ; et aux actions des régimes de droite et/ou fascistes qui instrumentalisent la pandémie pour réprimer toute contestation et mettre en place un pouvoir plus autoritaire. Pour reprendre les mots du philosophe argentin Miguel Benasayag, la pandémie est véritablement devenue un « rêve de tyran ». Dans mon propre pays, le président philippin Rodrigo Duterte a compté parmi les pires chefs d’État en matière de gestion de la pandémie. Tandis que lui et ses subalternes s’accrochent à leur position de pouvoir par le biais du militarisme généralisé, son régime a échoué à proposer un plan d’action global pour lutter contre la pandémie, et a aggravé l’état économique du pays, déjà déplorable. La dette Covid atteint désormais plusieurs billions de pesos philippins, une somme qui continue à augmenter. Pire encore, il organise ses programmes de « lutte contre le Covid-19» dans un cadre à la limite de la loi martiale, écrasant le débat, les dissidences et la résistance contre son régime. La police nationale et les Forces armées des Philippines sont non seulement chargées d’appliquer les programmes de santé publique, mais aussi, en parallèle, les politiques et plans anti-insurrectionnels de Duterte. Ces derniers se caractérisent par de nombreux cas de coercition et de harcèlement, ainsi que par des raids et assassinats visant des artistes, activistes, travailleurs sociaux, avocats, chercheurs et autres personnes désignées comme « dissidents » ou « terroristes communistes ».

Cette aggravation de la situation sur le terrain nous appelle à résister, à nous réunir, à nous rassembler et protester contre les situations de précarité. Mais comment protester quand le monde est à l’arrêt ? Où trouver un espace pour une action progressiste quand nous sommes dans cet « espace entre » ? Comment se rassembler et créer de la solidarité lorsque, aujourd’hui, être solidaire implique de garder ses distances ?
Le potentiel radical se trouve peut-être dans l’acte de reconnaître que, si la précarité est inégalement distribuée, elle demeure malheureusement une condition universelle. Ainsi, nos expériences communes de dépossession peuvent être considérées comme des points d’intersection et de solidarité, non seulement dans nos environnements et communautés à l’échelle locale, mais aussi dans un cadre international — l’union mondiale des dépossédés. Le potentiel radical de « l’espace entre » réside dans la transformation de cette union mondiale des dépossédés en une sorte de bienveillance radicale. S’accomplit alors ce que Butler décrit comme une forme de cohabitation interdépendante : une forme de vie n’est pas en position de privilège par rapport à une autre et la vie est « vivable » pour tous, pas seulement pour quelques heureux élus. Le potentiel radical de notre pratique créative réside peut-être dans le fait de trouver, comme le décrit Jacques Rancière dans sa Mésentente, « de nouvelles manières de donner un sens au sensible [et] de nouvelles configurations entre le visible et l’invisible, […] entre l’audible et l’inaudible, de nouvelles répartitions de l’espace et du temps – [et] de nouvelles capacités corporelles ». L’utilisation de l’art et de la performance pour réimaginer, recadrer, réinventer et trouver de nouvelles manières de voir et de faire est un outil puissant qui nous permet de donner du sens à notre « espace entre ».
Le corps en performance comporte un potentiel polémique, inhérent à sa matérialité et à sa façon d’occuper, de sculpter et d’habiter des espaces. Luttant contre différentes formes d’invisibilité et de privation de droits, il crée ce que Hannah Arendt appelle les « espaces des apparences ». En effet, alors que la performance est l’un des secteurs artistiques les plus touchés par la pandémie, elle a aussi été l’une des premières formes d’art à répondre à « l’invisibilité » dans laquelle nous a emprisonnés la pandémie, en créant des productions artistiques pendant le confinement. Qu’elles aient pris la forme de montages de ballerines dansant chez elles, de musiciens donnant des concerts confinés, ou de festivals et autres compagnies de performance basculant sur des plateformes virtuelles, ces réponses ont été de puissantes démonstrations de la résilience artistique et du droit de présenter, de se produire et d’apparaître. Elles ont également lancé des conversations très actuelles sur la situation précaire à laquelle faisaient face les secteurs créatifs, bien avant la pandémie. Cette « pratique de la performance à domicile » n’exprime pas seulement le dévouement infatigable de l’artiste à sa discipline : elle nous a aussi donné à nous, le public, un aperçu de leur environnement domestique et de leur mode de vie. Au travers de ces documentations de la présence de l’espace privé dans la sphère publique (virtuelle), nous avons été témoins de belles archives et d’un déluge de créativité, depuis et dans des espaces confinés, mais aussi de la manière dont ces espaces confinés ont pesé sur les artistes performeurs et sur chacun d’entre nous.
D’abord intimes, initiées par les artistes qui documentaient leur vie confinée, ces discussions ont aussi pris forme dans différents regroupements virtuels consacrés à l’économie et à l’écologie de la pratique artistique ainsi qu’aux structures de pouvoir qui les accompagnent. En octobre 2020, lors du colloque international « Conversations on Curation and Performance in the Time of Halting and Transformation » (Conversations sur la conservation et la performance à l’ère de l’arrêt et de la transformation), piloté par le groupe Performance Curators Initiatives (PCI), la chercheuse, conservatrice et enseignante de danse canadienne Dena Davida a évoqué les nombreuses réunions qui se tiennent en Amérique du Nord au sujet de l’avenir des arts performatifs. Essentiellement fréquentées par des artistes, des présentateurs, des directeurs de salles, des conservateurs, des universitaires et des programmateurs, ces rencontres ont étudié différentes questions, allant de la collecte de fonds pour les travailleurs et artistes les plus durement touchés dans le domaine des arts performatifs, à l’inégalité systémique causée par la dévaluation et la mauvaise gestion des fonds publics et le favoritisme dans leur attribution. Autre sujet, la transformation radicale de la danse et des arts performatifs en tant que champ d’études, qui voit les programmes de danse s’adapter aux défis soulevés par les mouvements récents de justice sociale tels que Black Lives Matter, ainsi qu’aux évolutions esthétiques qui ont surgi dans le sillage de la pandémie. L’ensemble de ce débat répond à un objectif : sortir de la pandémie avec une perspective plus humaine et attentionnée, et en imaginant des propositions pour restructurer les institutions et systèmes de soutien actuels dans les arts performatifs.
La provocation récurrente du colloque PCI 2020, à savoir de forger une « conservation du care » (mot anglais issu du latin curare dont est dérivée la pratique de la conservation), ou conservation bienveillante, invoque le caractère relationnel inhérent de la performance en développant la mission de conservation : outre les objets, elle doit désormais préserver les relations. La performance a toujours été une pratique relationnelle, qu’il s’agisse de créer un lien avec un public perçu, avec les participants au sein de la pratique, ou même avec des éléments non humains comme un espace, un lieu, une atmosphère ou un son. Cette pratique de la relation est une puissante manière de comprendre, d’appréhender et d’imaginer ce que pourrait être la conservation bienveillante, ainsi que de réfléchir à la façon dont cette conception de la conservation pourrait se transformer en modèle de bienveillance radicale, qui s’étendrait au-delà de la performance. Cela aboutirait à ce que Judith Butler décrit comme une obligation éthique à se préoccuper et à être responsables les uns des autres.
Lors de FRESH STREET #4, l’intervenant principal et organisateur du festival Sepehr Sharifzadeh a pris comme modèle la communication ouverte de son propre quartier, à Téhéran, afin d’illustrer cette obligation éthique à se préoccuper et à être responsables les uns des autres. Sharifzadeh a décrit l’habitude qu’ont ses voisins de prendre régulièrement des nouvelles les uns des autres, de demander s’ils vont bien ou s’ils ont besoin de quelque chose, et ce même avant la pandémie. Veiller sur son prochain était une pratique très répandue pendant la pandémie. Nous avons assisté à des manifestations de camaraderie et de soutien entre voisins, ainsi qu’à des actions collectives et à la mise en place d’organisations communes pour répondre aux besoins des communautés. Aux Philippines, par exemple, le groupe de solidarité entre artistes SAKA, ou Sama-sama ng Artista para sa Kilusang Agraryo (Alliance des artistes pour une véritable réforme du pays et un véritable développement rural), s’est concentré sur l’entretien des jardins et la gestion de cuisines communautaires, une démarche pensée comme un moyen d’action collectif pour lutter contre l’insécurité alimentaire dans les milieux pauvres, violemment touchés par la pandémie. Aux Philippines, le phénomène actuel des garde-manger communautaires a été lancé par l’artiste Patricia Non comme un simple et modeste garde-manger, contenant des produits de base comme le riz, les légumes, les fruits, l’alcool et les masques de protection. Il s’accompagnait d’un panneau indiquant « Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan », traduction approximative en philippin de la célèbre citation de Karl Marx : « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ». Cette pratique s’est répandue comme une traînée de poudre dans tout le pays, où le nombre de garde-manger communautaires est passé de un à cent en seulement une semaine.

Cependant, ces garde-manger communautaires ont rapidement attiré l’attention du gouvernement fasciste de Duterte. En quelques jours, les personnes à l’initiative de cette action ont été placées sur liste rouge (catégorisées comme étant de gauche, subversives, communistes ou terroristes) par la National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (unité opérationnelle nationale pour mettre un terme au conflit armé local contre les communistes), ce qui a entraîné la fermeture de plusieurs de ces garde-manger et le harcèlement des personnes qui les avaient mis en place. Dans ce cas précis, on pourrait déduire que, les systèmes actuels étant corrompus jusqu’à la moelle et résolument déterminés à maintenir notre condition de personnes précaires et dépossédées, la pratique de la bienveillance radicale exige aussi une action politique. Nos obligations éthiques les uns envers les autres impliquent aussi de nous engager dans une lutte pour l’obtention de droits collectifs qui limiteraient, voire éradiqueraient, toute situation de précarité, qu’elle soit économique, psychique, émotionnelle, environnementale ou politique. Ainsi, la bienveillance radicale doit aller au-delà des petites communautés, au-delà des quartiers. Thomas Horrocks, pasteur dans l’Indiana, aux États-Unis, a malicieusement déclaré qu’« aimer son prochain, c’est démanteler les systèmes qui l’oppressent ». Chiara Gusmeroli a repris cette idée lors de FRESH STREET, en soulignant la nécessité d’un engagement sans faille pour agir, participer, dénoncer, négocier, se regrouper et revendiquer « le droit d’apparaître ». Selon elle, « s’unir n’est que le commencement ; nous devons rester unis et travailler ensemble » pour continuer à faire pression sur les pouvoirs en place. Il en va de notre obligation éthique et de notre responsabilité collective de nous battre dans, avec et contre la précarité.
Cet appel à la responsabilité collective et à la construction d’une voix commune résonne désormais dans le monde entier. Au cours de l’événement « Globe Occupy : Remake the World/Remake the Globe », qui s’est tenu à Rome, en Italie, du 14 au 19 avril 2021, plus d’un an après le début officiel de la pandémie, la voix collective de l’Art, Entertainment, and Culture Workers’ Network (réseau des travailleurs de l’art, du divertissement et de la culture) a été portée haut et fort :
Aujourd’hui, nous déclarons que ça suffit ! […] Cette assemblée urbaine multiple et hétérogène occupe aujourd’hui un espace public afin d’affirmer avec vigueur la nécessité de repenser un secteur déjà en crise bien avant l’urgence sanitaire […]. Il est temps de faire converger les luttes, de sortir de l’invisibilité, de nous faire entendre […]. Nous n’avons pas besoin de rouvrir les théâtres et les espaces culturels si les conditions pour le faire en assurant la sécurité de tous ne sont pas réunies. Le soi-disant nouveau départ sans discrimination pénalise les expériences les plus fragiles et alimente la compétition, aggravant un système dont l’effondrement a déjà commencé. Choisir entre la santé et le travail n’est pas une option discutable. Nous devons repenser les structures de nos conditions de vie et de travail, en donnant à toutes les subjectivités qui existent en ville la possibilité d’imaginer des modèles durables, basés sur des pratiques collaboratives partant d’en bas et reproductibles ailleurs. Ce que nous avons vécu à fleur de peau ces derniers mois est simplement l’effondrement inévitable d’un système qui n’est tenable pour aucun d’entre nous ; effondrement qui, aujourd’hui, touche les plus fragiles, mais qui finira bientôt par désertifier le paysage tout entier. Nous revendiquons le droit à un revenu de base continu et à une formation payée et permanente, car le temps passé à chercher et à étudier relève bel et bien du travail. Nous avons besoin de nouveaux droits sociaux et de nouveaux mécanismes de protection, nous avons besoin d’outils contre la discrimination et les inégalités entre les individus. Le besoin d’un accès à l’art et à la culture pour tous émerge clairement. Nous défendons le caractère informel des espaces de production artistique et culturelle exclus des circuits de financement et réaffirmons la nécessité de revoir les critères de financement public. Dans cet espace public, qui se nourrit d’une étrange combinaison entre public et privé, aujourd’hui, nous jurons. Aujourd’hui, nous y entrons pour en sortir, et nous vous invitons à le faire avec nous. Construisons un discours collectif dans lequel chacun peut se reconnaître et commencer sans attendre à imaginer, ensemble, de nouveaux paradigmes, de nouveaux statuts, de nouveaux droits sociaux pour le travail précaire, indépendant et intermittent. Nous invitons les indépendants, artistes, techniciens, opérateurs, compagnies, institutions artistiques et culturelles, théâtres, festivals, centres de recherche, espaces formels et informels à soutenir notre lutte.
Entendons l’appel. L’heure est venue.

Roselle Pineda (Philippines) est éducatrice, chercheuse, conservatrice, dramaturge et travailleuse culturelle. Elle est la fondatrice, directrice artistique et conservatrice de l’Aurora Artist Residency Program and Space (AARPS) et de la Performance Curators Initiatives (PCI). Elle enseigne au département des études artistiques de l’université des Philippines, à Diliman, et prépare actuellement un doctorat en arts créatifs sur la recherche créative fondée sur la pratique et les arts communautaires à l’université de Wollongong, en Australie
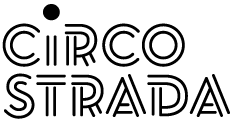


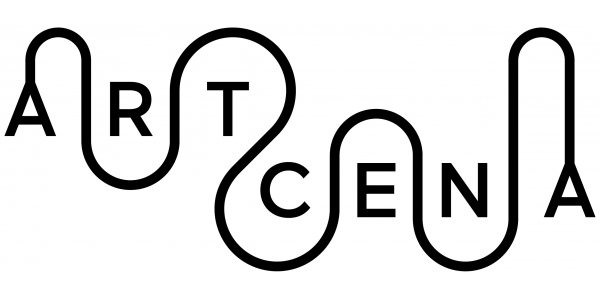


écrivez-nous : infocircostrada@artcena.fr